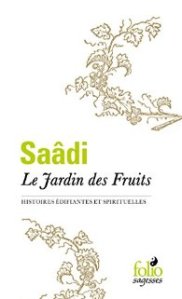Aleister Crowley fut un expérimentateur, pour le meilleur et pour le pire. J’ai entendu son nom pour la première fois lorsqu’un ami m’a conseillé son Journal d’un drogué, en rapport avec mes travaux passés sur le psychédélisme. Je n’ai toujours pas lu ce journal, mais la même personne m’a offert un peu plus tard La Goetia : Petite clé du Roi Salomon, au moment de sa réédition. Ce livre, co-écrit avec S. L. MacGregor Mathers, par ailleurs le beau-frère de Henri Bergson, puisqu’il était marié avec Moina Bergson, est une petite encyclopédie des démons et des formules rituelles pour les invoquer. Crowley ressemblait à un personnage tout droit sorti d’un roman de Huysmans. Un documentaire un peu suspect de Neil Rawles, datant de 2002, le présente même comme The Wickedest Man of the World, « L’Homme le plus malsain du monde ». Je ne rentrerai pas dans les polémiques concernant son existence et ses actes, puisque les sources sont assez troubles et qu’il est difficile de faire la part du vrai et du faux.

S. L. MacGregor Mathers en tenue égyptienne, effectuant un rituel de l’Aube dorée. Il fut un collaborateur de Crowley. Photo d’avant 1918.
Crowley est devenu après sa mort une icône de l’ésotérisme pop. La musique rock et metal lui a souvent rendu hommage, par exemple David Bowie dans Quicksand ou Bruce Dickinson d’Iron Maiden, qui lui a consacré avec Julian Doyle un film, Chemical Wedding (Le Diable dans le sang, 2008), du genre nanard. Crowley illustre en cela le phénomène assez étrange de l’entrée de l’ésotérisme dans la culture populaire. Les credos des sociétés secrètes se sont transformés en conseils thérapeutiques New Age. Crowley peut facilement être rangé soit du côté des charlatans et des illuminés, soit du côté des visionnaires et des élus. Il affirmait qu’il était la réincarnation d’Éliphas Lévi, un occultiste français du XIXe mort l’année de sa naissance. Il a systématisé tout un tas de pratiques sous le nom de Magick, regroupant la démonologie, le tarot, l’initiation aux mystères, les rituels de sociétés secrètes, la symbolique égyptienne et alchimique, la kabbale, la numérologie, l’astrologie, et des idées trouvées dans le pythagorisme et chez l’anthropologue J.G. Frazer. Autant dire que sa pensée repose surtout sur des analogies et des correspondances, ce dont il était tout à fait conscient d’ailleurs. Crowley avait même un côté iconoclaste et irrévérencieux, puisqu’il écrit à plusieurs reprises dans le Livre de Thoth, son manuel de tarologie établi avec Lady Frieda Harris qui en a dessiné les cartes, que peu importe les sources originales puisqu’elles sont perdues à jamais. L’important n’est pas selon lui de retrouver une tradition qui n’existe plus, mais de faire preuve de cohérence dans la pratique magique. Il s’éloignait ainsi des occultistes obsédés par la tradition qui se querellaient à propos de savoir qui ou quelle école possédait la bonne interprétation.
Ses photographies ont quelque chose de troublant. Crowley ressemblait à un mélange entre un dandy anglais, un poète surréaliste qui aimait jouer avec les symboles et un initié au regard illuminé. C’est cela que je retiens de lui : pour moi, il est avant tout un poète, un « fou littéraire », selon l’expression de Nodier et Brunet. Ses livres nous font voyager à travers les mythes et les images, ils parodient la pensée rationnelle, n’expliquent pas toujours leurs présupposés. C’est tout le paradoxe de publier sur des thèmes ésotériques : il y a la volonté de rendre publiques et accessibles des idées, dont on affirme en même temps qu’elles sont cachées et masquées aux non initiés. Crowley a commencé sa carrière d’écrivain par des poèmes de jeunesse, et il a appartenu à la même société secrète que W.B. Yeats, l’Ordre hermétique de l’Aube dorée. D’un point de vue littéraire, Crowley était un post-symboliste ou un post-romantique, l’un des disciples à Saïs, le cousin des surréalistes, qui ont largement utilisé la symbolique ésotérique, comme en témoigne Arcane 17 d’André Breton. Mais Crowley croyait vraiment à ces imaginations poétiques, ce qui finit par l’exclure de la communauté littéraire. Il rejoignit la cohorte des auteurs refoulés par la société, qui font partie de l’ombre tout en ayant une certaine célébrité due à Internet et à la musique pop.
Thrill with lissome lust of the light,
O man ! My man !
Come careering out of the night
Of Pan ! Io Pan .
Io Pan ! Io Pan ! Come over the sea
From Sicily and from Arcady !
Roaming as Bacchus, with fauns and pards
And nymphs and styrs for thy guards,
On a milk-white ass, come over the sea
To me, to me,
Come with Apollo in bridal dress
(Spheperdess and pythoness)
Come with Artemis, silken shod,
And wash thy white thigh, beautiful God,
In the moon, of the woods, on the marble mount,
The dimpled dawn of of the amber fount !
Dip the purple of passionate prayer
In the crimson shrine, the scarlet snare,
The soul that startles in eyes of blue
To watch thy wantoness weeping through
The tangled grove, the gnarled bole
Of the living tree that is spirit and soul
And body and brain – come over the sea,
(Io Pan ! Io Pan !)
Devil or god, to me, to me,
My man ! my man !
Come with trumpets sounding shrill
Over the hill !
Come with drums low muttering
From the spring !
Come with flute and come with pipe !
Am I not ripe ?
I, who wait and writhe and wrestle
With air that hath no boughs to nestle
My body, weary of empty clasp,
Strong as a lion, and sharp as an asp-
Come, O come !
I am numb
With the lonely lust of devildom.
Thrust the sword through the galling fetter,
All devourer, all begetter;
Give me the sign of the Open Eye
And the token erect of thorny thigh
And the word of madness and mystery,
O pan ! Io Pan !
Io Pan ! Io Pan ! Pan Pan ! Pan,
I am a man:
Do as thou wilt, as a great god can,
O Pan ! Io Pan !
Io pan ! Io Pan Pan ! Iam awake
In the grip of the snake.
The eagle slashes with beak and claw;
The gods withdraw:
The great beasts come, Io Pan ! I am borne
To death on the horn
Of the Unicorn.
I am Pan ! Io Pan ! Io Pan Pan ! Pan !
I am thy mate, I am thy man,
Goat of thy flock, I am gold , I am god,
Flesh to thy bone, flower to thy rod.
With hoofs of steel I race on the rocks
Through solstice stubborn to equinox.
And I rave; and I rape and I rip and I rend
Everlasting, world without end.
Mannikin, maiden, maenad, man,
In the might of Pan.
Io Pan ! Io Pan Pan ! Pan ! Io Pan !
Aleister Crowley, « Hymn to Pan »
Bibliographie :
-André Breton, Arcane 17, Paris, Jean-Jacques Pauvert éditeur, 1989.
-Aleister Crowley, Journal d’un drogué, Rosières-en-Haye, Camion Blanc, 2011.
-Aleister Crowley, Le Livre de Thoth, Rayol-Canadel-sur-Mer, Alliance Magique, 2016. Collaboration avec Lady Frieda Harris.
-Aleister Crowley et Samuel Liddell Mathers, La Goetia : Petite clé du Roi Salomon, Rayol-Canadel-sur-Mer, Alliance Magique, 2017.
-Joris-Karl Huysmans, Là-Bas, Paris, Gallimard, 1985.
-Philomneste Junior, Les Fous littéraires, essai bibliographique sur la littérature excentrique, les illuminés, visionnaires, etc., Bruxelles, Gay et Doucé, .
-Charles Nodier, Bibliographie des fous : De quelques livres excentriques, Paris, Techener, .
-Novalis, Les Disciples à Saïs, Hymnes à la nuit, Chants religieux, Paris, Gallimard, 1980.